Les buveurs invétérés de café, d’alcool ou de sodas seraient-ils victimes de leurs gènes ? C’est l’hypothèse testée dans le cadre d’une vaste étude visant à identifier les gènes associés aux niveaux de consommation de boissons au goût amer ou sucré.
Une étude d’association pangénomique
Pour ce faire, les chercheurs ont mené une étude d’association pangénomique[1] (GWAS pour Genome-Wide Association Study) auprès de 370 000 Anglais et Américains d’ascendance européenne issus de différentes cohortes.
Première étape : caractériser les niveaux de consommation des différentes boissons des participants, grâce à des questionnaires et des enregistrements alimentaires sur 24 heures.
Les boissons au goût amer incluaient le café, le thé, le jus de pamplemousse, le vin rouge, les alcools forts et la bière. Les boissons au goût sucré incluaient des boissons contenant du sucre ajouté ou des édulcorants (ex. sodas), les jus de fruits et les boissons lactées aromatisées ou au chocolat.
Les chercheurs ont ensuite séquencé le génome des participants, afin de rechercher d’éventuelles relations entre les variations génétiques[2] observées chez les individus et leurs niveaux de consommation de boissons amères ou sucrées.
Un lien entre goût amer et gènes liés au métabolisme de la caféine
Les participants consommant beaucoup de boissons amères présentaient des variants génétiques spécifiques au niveau de cinq gènes, connus pour être impliqués dans le métabolisme de la caféine.
Ces participants présentaient d’autres spécificités génétiques ressortant lorsque les différents types de boissons amères étaient considérés séparément.
Ainsi, chez les forts consommateurs de café, des associations positives ont par exemple été trouvées entre certains variants génétiques et un indice de masse corporelle élevé.
Quand l’indice de masse corporelle s’en mêle
Pour les boissons au goût sucré contenant des sucres ajoutés, une association inattendue a été observée dans les deux cohortes : les faibles consommateurs de ces boissons présentaient la forme du gène FTO connue pour être associée à un risque accru de surpoids et d’obésité.
Peu compris par les chercheurs mais déjà rapporté dans une étude antérieure, ce résultat mériterait des investigations complémentaires.
Peu d’associations avec les gènes de la perception gustative
Enfin, un dernier résultat a retenu l’attention des auteurs : très peu d’associations ont été mises en évidence entre les niveaux de consommation des différentes boissons et les gènes connus pour réguler la signalisation des perceptions amères et sucrées.
Ce résultat paraît surprenant : les habitudes de consommation des boissons seraient ainsi davantage liées à des gènes codant pour des protéines impliquées dans le métabolisme des composés absorbés (comme la caféine) ou des paramètres anthropométriques (comme l’indice de masse corporelle), qu’aux gènes liés à la perception du goût.
Là encore, des investigations complémentaires seront nécessaires.
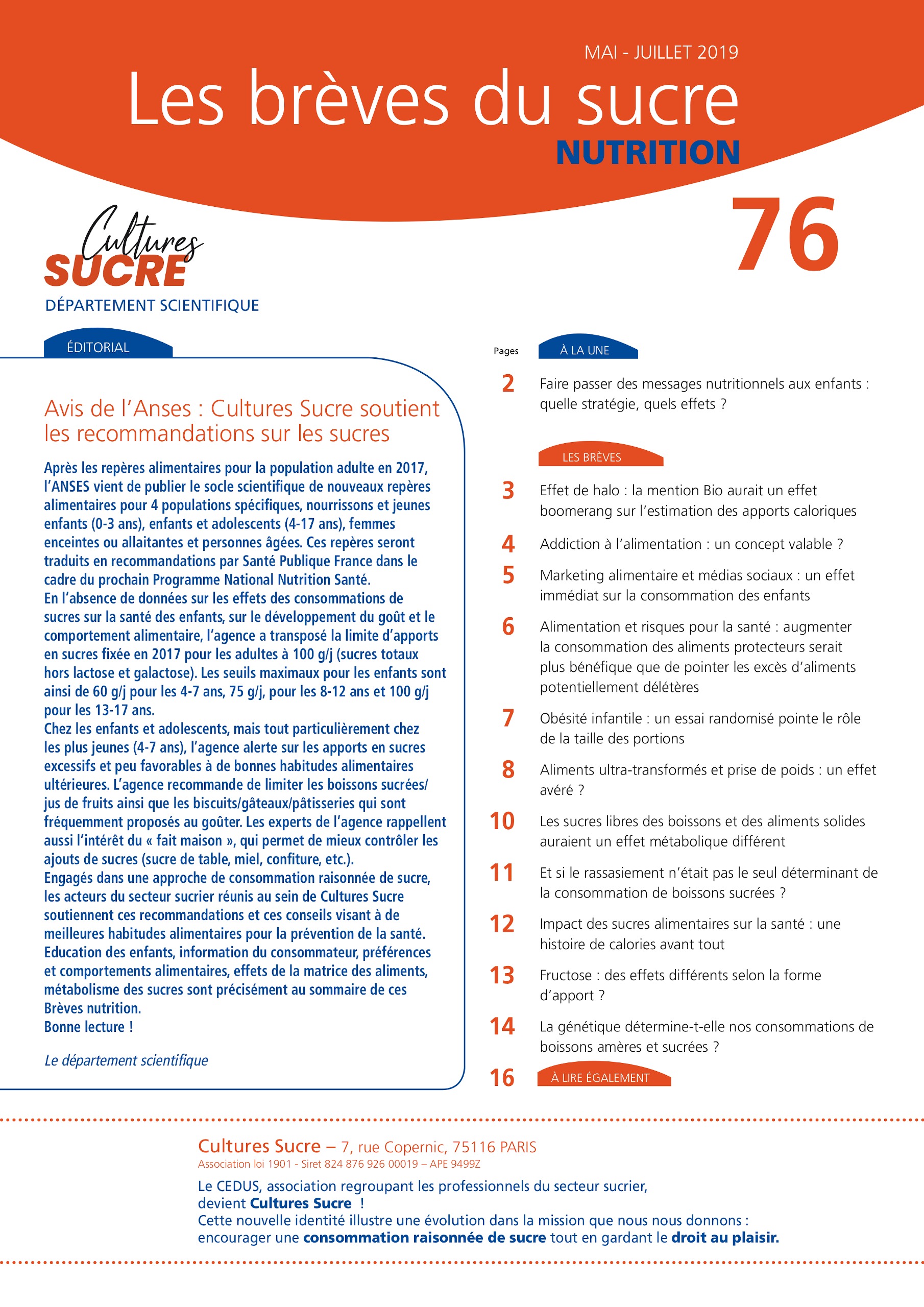 Télécharger les Brèves nutrition n°76
Télécharger les Brèves nutrition n°76
Télécharger